L’idéologie woke. Anatomie du wokisme (1)
Introduction
Le système de pensée woke
Une assertion postmoderne : le savoir résulte du pouvoir, non de la connaissance
Les trois étapes de la philosophie postmoderne
Les branches académiques
La matrice intersectionnelle
La récusation de la norme par l’exception
Des concepts philosophiques et sociologiques aux méthodes d’action
La stratégie virale
Les conditions culturelles et sociales de l’émergence du wokisme
Contre la culture de l’honneur et contre la culture de la dignité : la promotion d’une culture de la victimisation
Promouvoir l’intervention de tierces personnes pour la gestion des griefs
Atomisation sociale et bureaucratisation des rapports sociaux
La psychologie woke
Une dérive éducative : surprotection et safetyism
La psychologisation des griefs
Exposition aux écrans, troubles psychologiques et wokisme
Les conséquences individuelles du wokisme
Accentuation des troubles psychologiques
Un complotisme favorisant l’intolérance aux désaccords
Théories infalsifiables, biais de confirmation et raisonnements circulaires
Résumé
Le début des années 2010 a vu surgir un phénomène qui s’est lui-même nommé « woke ». Être « woke » signifie être « éveillé ». Il s’agit ici d’être éveillé aux injustices que subissent les minorités dans les pays occidentaux. Par certains aspects, cette idéologie procède du postmodernisme. Elle connaît une forte progression. L’émergence de cette nouvelle culture morale, dans laquelle le statut de victime devient une ressource sociale, requiert certaines conditions, parmi lesquelles on trouve, notamment, une atomisation sociale et un niveau de diversité ethnique et sexuelle élevé. La bureaucratisation et la juridisation de la société jouent également comme des facteurs essentiels, assurant la reconnaissance de ce statut de victime par des tiers détenteurs de l’autorité et permettant d’imposer un véritable « ordre woke ».
Ces conditions sont toutes plus ou moins présentes dans les sociétés occidentales mais plus particulièrement sur le campus des universités américaines, là où le « wokisme » y est le plus influent.
Le plus souvent, les militants sont issus de familles aisées. Enfants, ils ont connu de trop brefs moments de jeu libre et sans surveillance. Adultes, ils peinent à se débarrasser de l’habitude prise consistant à rechercher une autorité instituée en cas de conflit avec une autre personne au lieu de le régler directement eux-mêmes. L’une des conséquences est la croissance d’une bureaucratie universitaire chargée de poursuivre et de prolonger cet état de surprotection.
Certains observateurs parient sur le fait que ce mouvement, porté essentiellement par des jeunes, reste circonscrit aux universités américaines. Cependant, force est de constater qu’il progresse rapidement, à la fois à l’extérieur des campus et en dehors des États-Unis.
Pierre Valentin,
Étudiant en master science politique à l'université Paris-2 Panthéon-Assas, diplômé en philosophie et politique de l'université d’Exeter (Royaume-Uni).

L’idéologie woke. Face au wokisme (2)

Contester les technosciences : leurs raisons

Contester les technosciences : leurs réseaux

Covid-19 : la réponse des plateformes en ligne face à l'ultradroite

La contestation animaliste radicale

La gauche radicale : liens, lieux et luttes (2012-2017)

Démocraties sous tension - Volume I. Les enjeux

Démocraties sous tension – Volume II. Les pays

Les zadistes (1) : un nouvel anticapitalisme

Les zadistes (2) : la tentation de la violence
Introduction
Pour un bon résumé des événements d’Evergreen, voir Douglas Murray, The Madness of Crowds. Gender, Race and Identity, Bloomsbury Publishing, 2019, p. 128-132.
Cité in Elijah C. Watson, « The Origin Of Woke: How Erykah Badu And Georgia Anne Muldrow Sparked The “Stay Woke” Era », okayplayer.com, 2018 [trad. de l’auteur].
Pour un bon résumé sur les origines du mot, voir « Qu’est-ce que le woke ? 2. Les origines », ctrlzmag.com, 25 février 2021.
Voir Marc-Olivier Bherer, « Ne soyez plus cools, soyez “woke” », lemonde.fr, 3 mars 2018.
Cité in Mathieu Bock-Côté, La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, 2021, p. 72.
Depuis les années 1970, l’université américaine d’Evergreen observait une tradition baptisée « Jour d’absence », au cours de laquelle les professeurs et les étudiants non blancs quittaient le campus et se réunissaient ailleurs. L’acte cherchait à rappeler à quel point les non-blancs étaient précieux dans la vie du collège. Mais, en 2017, les organisateurs ont inversé les choses et ont exigé que les professeurs et les étudiants blancs quittent le campus. Un professeur de biologie, Bret Weinstein, s’y est opposé, jugeant qu’il y avait une distinction fondamentale entre un groupe qui décide de ne pas venir sur le campus de sa propre initiative et un groupe qui interdit à un autre de venir. Ce professeur progressiste se trouva immédiatement confronté à la colère de certains étudiants, puis à diverses mesures de rétorsion et enfin à des agressions quotidiennes. Face à l’hostilité de l’administration universitaire, le professeur et sa compagne, craignant pour leur sécurité, quittèrent les lieux définitivement1.
De nombreux observateurs se sont depuis penchés sur ce type de phénomène, qui a été désigné peu à peu par le terme « woke ». Si certains n’ont vu au départ dans cet événement qu’un fait propre aux campus américains, force est de constater que des comportements que l’on croyait circonscrits aux universités des États-Unis se sont déversés dans nombre de nos sociétés occidentales. En effet, depuis l’été 2020, à la suite de la mort de George Floyd fin mai, le phénomène s’est étendu et intensifié en même temps que le mouvement « Black Lives Matter » prenait une place médiatique considérable. Face à cette nouvelle culture morale, beaucoup expriment dorénavant une forme d’incompréhension, voire d’inquiétude.
Un petit retour en arrière sur l’expression being woke s’impose. Cette expression s’est d’abord popularisée aux États-Unis dans la communauté afro-américaine, où elle fait des apparitions sporadiques tout au long du XXe siècle. Mais il faut attendre 2008 pour voir le terme accéder à la notoriété, grâce au morceau de RnB Master Teacher d’Erykah Badu2. Pendant le refrain, la musicienne Georgia Anne Muldrow clame : « I stay woke » (« Je reste éveillée ») et, lors d’un entretien réalisé en 2018, elle explique : « Être woke est définitivement une expérience noire […]. [C’est] comprendre ce que vos ancêtres ont traversé. Être en contact avec la lutte que notre peuple a menée ici et comprendre que nous nous battons depuis le jour où nous avons atterri ici3. » Si le terme vient se détacher partiellement des luttes afro-américaines lorsque Erykah Badu soutient en 2012 les actions de Pussy Riot, il ne se propage de manière significative qu’à partir du moment où le mouvement Black Lives Matter s’en empare en 2013 et 20144.
Contrairement à ce que l’on peut lire très souvent, le terme « woke » n’est donc pas d’abord un anathème créé par ses adversaires mais une auto- désignation. Son caractère péjoratif ne se développera que progressivement, dans les feux de la critique. D’ailleurs, en 2016, le documentaire sur le mouvement Black Lives Matter réalisé avec certains membres du mouvement s’intitulait Stay Woke: The Black Lives Matter Movement5. En 2018, le quotidien Le Monde considérait encore qu’« être woke » avait plus ou moins pour synonyme « être cool » dans la culture noire américaine6.
Ce terme se prête également à une définition relativement précise. Radio- Canada, par exemple, utilise la définition suivante : « Dans un contexte de combat en matière de justice sociale, cette expression définit quelqu’un qui est sensibilisé aux injustices qui peuvent avoir lieu autour de lui. On utilise souvent cette expression en opposition à “être endormi”, soit ne pas être éduqué sur les enjeux socio-économiques et sur les questions raciales7. »
Cette étude présente dans les grandes lignes l’idéologie woke. Elle s’attache à étudier les conditions culturelles et sociales de son émergence, ce qui appelle la prise en compte des travaux éclairant la psychologie de ses militants.
Le système de pensée woke
Helen Pluckrose et James Lindsay, Cynical Theories. How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity – and Why This Harms Everybody, Pitchstone Publishing, 2020 [les passages de cet ouvrage cités dans cette note sont des traductions proposées par l’auteur].
Voir Alan Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Odile Jacob, 1997 ; 2e éd., 1999 (disponible en format poche, Odile Jacob, 2018).
Cette section abordera brièvement le système de pensée du mouvement woke. L’ouvrage Cynical Theories de Helen Pluckrose et James Lindsay publié en 20208 est le plus complet sur ce sujet. Les deux auteurs s’étaient déjà fait connaître en 2018 pour leurs canulars académiques réalisés avec Peter Boghossian qui visaient à décrédibiliser certaines revues postmodernes, une opération baptisée « Sokal au carré » en référence à la même supercherie mise en œuvre par Alan Sokal et Jean Bricmont dans les années 19909. Selon Lindsay et Pluckrose, le wokisme est un enfant paradoxal de la pensée postmoderne.
Une assertion postmoderne : le savoir résulte du pouvoir, non de la connaissance
Helen Pluckrose et James Lindsay, op. cit., p. 30.
Ibid.
Michel Foucault, Surveiller et punir [1975], in Œuvres, II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2015, p. 288-289.
Jacques Derrida, « Signature, événement, contexte », communication au Congrès international des Sociétés de philosophie de langue française, Montréal, août 1971, p. 19. Le même thème est également exploré dans son ouvrage d’entretiens Positions, Éditions de Minuit, 1972.
Helen Pluckrose et James Lindsay, op. cit., p. 40.
Pierre-André Taguieff, L’Imposture décoloniale. Science imaginaire et pseudo-antiracisme, Éditions de l’Observatoire, 2020, p. 52.
Helen Pluckrose et James Lindsay, op. cit., p. 42.
Le mouvement woke revendique sur une approche postmoderne du savoir caractérisée par « un scepticisme radical quant à la possibilité d’obtenir une connaissance ou une vérité objective10 ». Le wokisme défend « l’idée selon laquelle la société est formée de systèmes de pouvoir et de hiérarchies qui décident de ce qui peut être su et comment11 ».
On retrouve ici l’influence de Michel Foucault et de l’un de ses thèmes de réflexion de prédilection associant le pouvoir et le savoir : « Il faut plutôt admettre que le pouvoir produit du savoir (et pas simplement en le favorisant parce qu’il le sert ou en l’appliquant parce qu’il est utile) ; que pouvoir et savoir s’impliquent directement l’un l’autre ; qu’il n’y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d’un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir12. »
La problématique « savoir-pouvoir » se révèle déterminante pour comprendre les racines de la philosophie woke. Selon ce point de vue, le savoir déployé au nom des progrès de la connaissance ne serait en réalité qu’une expression du pouvoir. Face à la production d’une connaissance, d’un savoir, les questions qui se posent doivent donc devenir : d’où provient ce savoir et à qui profite-t-il ? La problématique « savoir-pouvoir » assure la cohérence entre les deux principes postmodernes car si l’on accepte que savoir et pouvoir sont indissociablement liés, alors il en découle l’idée que c’est en réalité le pouvoir qui décide de ce qui peut et doit être su, et non la science. La connaissance ne serait donc que l’expression du pouvoir à l’œuvre, d’où le scepticisme radical de la pensée woke quant à la possibilité de produire des connaissances objectives.
Selon Pluckrose et Lindsay, le postmodernisme se caractérise par quatre thèmes :
– le brouillage des frontières y occupe tout d’abord une place de choix : toute distinction, séparation ou classification est relativisée et rendue compliquée, dans le but affiché de dénier une véritable pertinence à quelque catégorie que ce soit, ce qui permet de perturber les systèmes de pouvoir. Ici aussi la pensée de Foucault, mais également celle de Jacques Derrida, surgit puisque, pour eux, une distinction masque généralement une hiérarchisation ; celui qui distingue les catégories hommes-femmes, par exemple, cherche à légitimer la domination des premiers sur les secondes. Pour Derrida, les binaires sont des structures de pouvoir qui oppriment et doivent donc être déconstruites, car « une opposition de concepts métaphysiques (par exemple, parole/écriture, présence/absence, etc.) n’est jamais le vis-à-vis de deux termes, mais une hiérarchie et l’ordre d’une subordination13 ». Il faut donc déconstruire ces distinctions et les flouter ;
– le deuxième thème est le pouvoir accordé au langage, censé construire plus ou moins entièrement notre perception du réel. Ce thème apparaît sous la plume de Heidegger mais aussi de Derrida, dans ses ouvrages De la grammatologie, Écriture et Différence, et La Voix et le Phénomène. Comme le rappellent Pluckrose et Lindsay, dans ses travaux « Derrida rejette l’idée de bon sens selon laquelle les mots se réfèrent directement aux choses dans le monde réel. Au contraire, il insiste sur le fait que les mots ne se réfèrent qu’à d’autres mots et à la manière dont ils diffèrent les uns des autres, formant ainsi des chaînes de “signifiants”, qui peuvent partir dans toutes les directions sans aucun point d’ancrage14 ».Ici, une séparation nette entre les discours et la réalité objective (le point d’ancrage) est implicite ;
– le troisième thème, le relativisme culturel, postule l’impossibilité de classer une culture comme supérieure ou inférieure à une autre. Il faut noter que Pluckrose et Lindsay oublient de préciser à ce stade que, parmi les différentes branches de la pensée postmoderne, la pensée décoloniale fera un usage paradoxal de ce thème, postulant parfois de manière plus ou moins voilée une infériorité de la culture occidentale par rapport aux cultures « indigènes ». Pierre-André Taguieff note par exemple que « la relativisation décoloniale s’arrête à l’islam, placé hors des formes culturelles critiquables, sanctuarisé comme intouchable, […] le seul véritable “agent révolutionnaire” dans le monde contemporain15 » ;
– le dernier thème est celui de l’éviction de l’individu et de l’universel, tous deux perçus comme des fictions issues des Lumières, masques de la domination blanche. Pour Pluckrose et Lindsay, chez les postmodernes, « le concept d’universel […] est au mieux naïf. Dans le pire des cas, il s’agit simplement […] d’une tentative d’imposer les discours dominants à tous16 ». Quant à l’individu libre et rationnel décrit par la modernité, il n’est en réalité que le résultat illusoire des structures de pouvoir et de leurs discours.
Les trois étapes de la philosophie postmoderne
Voir Mary Poovey, « Feminism and Deconstruction », Feminist Studies, vol. 14, n° 1, été 1988, p. 51-65.
Voir Heather Bruce, Robin DiAngelo, Gyda Swaney (Salish) et Amie Thurber, Between Principles and Practice: Tensions in Anti-Racist Education, Race and Pedagogy National Conference, University of Puget Sound, septembre 2014.
Pluckrose et Lindsay résument l’évolution de la pensée postmoderne en trois étapes. La première, pendant les années 1960-1970, est celle du postmodernisme descriptif qui rejette les métarécits, comme le marxisme ou le christianisme, et se contente de déconstruire les discours dans lesquels seraient cachées des structures de pouvoir en évitant d’émettre des propos trop ouvertement normatifs. Au milieu des années 1980, cette grande phase de déconstruction s’essouffle, et beaucoup y voient encore aujourd’hui la fin du premier postmodernisme. Or, selon ces auteurs, c’est à ce moment-là que le postmodernisme a muté, sa forme originale étant vouée à s’autodétruire.
Dans une deuxième étape, de la fin des années 1980 à 2010, les textes deviennent normatifs, et la déconstruction se transforme en un système d’injonction morale. Devant les décombres laissés par les déconstructeurs précédents, les nouveaux postmodernes se voient contraints de reconstruire un monde, supposé meilleur, tout en restant fidèles à leurs principes et à leurs thèmes. C’est dans l’abandon du scepticisme radical que le postmodernisme originel sera modifié. Il s’agit alors de réduire sa portée intellectuelle pour accroître son pouvoir politique. Ce travail se fera notamment avec l’aide de Kimberlé Crenshaw, théoricienne de l’« intersectionnalité », en accordant une place inédite à l’idée d’un pouvoir omniprésent et source de corruption morale, aux catégories d’oppresseur et d’opprimé, qui sont admises comme des réalités objectives, de même que la discrimination, dont la réalité n’est pas contestée. La féministe Mary Poovey notera également que si les méthodes de déconstruction permettent de saper les stéréotypes de genre, une vision trop radicale de la déconstruction pourrait empêcher la catégorie « femme » d’exister. Or, pour défendre la femme opprimée contre l’homme qui l’opprime, il faut que ces catégories aient un sens et ne soient pas dissoutes par le scepticisme17.
La troisième et dernière étape, celle du wokisme tel qu’il s’observe aujourd’hui, a débuté autour de 2010, et se voit désigné du nom de « postmodernisme réifié » (ou « concrétisé ») par Pluckrose et Lindsay. Ce qui s’était amorcé dans les années 1960-1970 comme une critique des métarécits devient à son tour un métarécit, qui discerne dans la déconstruction d’une réalité jugée « problématique » la condition de l’émancipation des minorités et de « l’Autre » sous toutes ses formes. Ici, la boucle est bouclée car ce qui a commencé sous la forme de descriptions (première étape) et qui a muté en injonctions (deuxième étape) se termine sous la forme d’injonctions dissimulées dans des descriptions (troisième étape). Les prémisses morales du postmodernisme deviennent invisibles aux yeux de ses adeptes car trop évidentes. Le ton change en conséquence au fur et à mesure qu’ils pensent parler de faits établis et non de théories. C’est ainsi que, par exemple, la théorie critique de la race (critical race theory, ou CRT), l’une des branches les plus populaires du wokisme, ne se demande plus si du racisme existe dans une certaine interaction sociale (une évidence, à leurs yeux), mais bien comment celui-ci se manifeste18. Une fois plongés dans ce paradigme, leur survie académique dépendant de leur capacité à dénicher des injustices raciales invisibles au commun des mortels, ces théoriciens sont contraints d’en « découvrir » de multiples autres. C’est la dernière étape du postmodernisme. Elle marque le moment où ces idées franchissent le mur des départements de sciences sociales en progressant dans le monde des médias, des entreprises et, plus globalement, dans l’espace public américain puis occidental.
Les branches académiques
Les études postcoloniales sont résumées ainsi par Pierre-André Taguieff : « Sous la présupposition que l’héritage colonial – cognitif, culturel, et sociopolitique – est partout, l’impératif décolonial est ainsi formulable : tout déconstruire pour tout décoloniser19. » Le tout afin de sauver l’Autre, lequel prend ici essentiellement la forme de l’étranger, de l’immigré et de la minorité ethnique.
La théorie queer, dont la figure la plus connue est Judith Butler, promeut l’idéal de fluidité dans les notions de genre afin de rompre la rigidité des catégories telles que « homme » ou « femme » dans lesquelles on ne voit que des sources d’oppression. Sera queer ce qui n’est pas catégorisable sous la forme d’un binaire, à savoir toute personne homosexuelle, bisexuelle, pansexuelle, transgenre, non binaire ou aux attributs combinés de cette série et tout autre membre de la communauté LGBTQ. Tout peut devenir queer, à condition, selon l’un de ses théoriciens, David Halperin, « d’être en opposition avec la norme, le légitime, le dominant20 ».
La théorie critique de la race est née dans les années 1970 mais elle n’a pris de l’ampleur que dans les années 1980-1990. Elle postule un rejet de la vision libérale et universaliste qui se veut colorblind (aveugle aux couleurs). Pluckrose et Lindsay la résument ainsi : « Le racisme est présent partout et à tout moment, et agit de manière soutenue au détriment des personnes de couleur, qui en sont conscientes, et au profit des personnes blanches, qui ont tendance à ne pas en avoir conscience, comme le permet leur privilège21. » Le penseur woke Ibrahim X. Kendi dira même : « L’individu aveugle à la couleur, en refusant de voir la race, ne voit pas le racisme et tombe dans une passivité raciste. Le langage de cette cécité à la couleur – tout comme le langage du “pas raciste” – est un masque pour cacher le racisme22. »
La matrice intersectionnelle
Voir Kimberlé Crenshaw, « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Stanford Law Review, vol. 43, n° 6, juillet 1991, p. 1241-1299.
Helen Pluckrose et James Lindsay, op. cit., p. 155.
Ibid., p. 166.
De la théorie critique de la race naîtra en 1989 le concept d’« intersectionnalité » promu par Kimberlé Crenshaw. L’idée est qu’il est possible de discriminer ou de subir des discriminations selon plusieurs axes, comme un individu au milieu d’un carrefour pourrait être percuté par des voitures provenant de différents côtés23. Ainsi, l’homme blanc homosexuel est moins opprimé par la société que la femme noire lesbienne handicapée car il est par ailleurs dominant sur plusieurs axes (homme, de race blanche), contrairement à la femme. Il n’y a pas, par principe, de limite au nombre d’axes de domination, et les militants ne se privent pas d’en rajouter, ce concept se révélant particulièrement riche en nouvelles discriminations à analyser, permettant de multiplier les raisons d’accéder au statut de victime.Cette notion s’est rapidement répandue, notamment chez les féministes. L’identité ethnique et sexuelle prenant une immense importance, savoir « d’où l’on parle » (une injonction déjà très présente lors des événements de Mai-68) devient une clé. Selon Pluckrose et Lindsay, « en 2006, le féminisme au sein des études de genre en est venu à s’appuyer sur quatre principes fondamentaux : 1. Le genre joue un rôle très important dans la manière dont le pouvoir est structuré dans la société ; 2. Le genre est socialement construit ; 3. Les structures de pouvoir liées au genre privilégient les hommes ; 4. Le genre se combine avec d’autres formes d’identité24 ».
Parmi les axes de domination considérés dans le schéma intersectionnel, les plus récents sont ceux du surpoids et du handicap. Les penseurs des disability studies ne perçoivent pas le handicap comme quelque chose d’individuel mais comme un concept imposé par une société malveillante. Ils accusent de « validisme » ceux qui pensent qu’il y aurait une norme physique humaine. Dans leur logique, il ne faudrait pas chercher à guérir le handicap car ce désir impliquerait une hiérarchisation et dissimulerait même la volonté de vouloir éradiquer les handicapés (et pas seulement le handicap, distinction qu’ils brouillent). Pluckrose et Lindsay notent que, chez ces penseurs, « le souhait exprimé de prévenir ou de guérir le handicap est souvent reformulé de manière choquante comme un souhait que les personnes handicapées (et non leur handicap) puissent ne pas exister – un stratagème cynique qui joue sur les mots25 ». Face à la lame de fond que semble représenter la forte augmentation des troubles mentaux dans les jeunes générations (voir la partie III de cette note), il se révèle difficile de déterminer si la prolifération récente des disability studies qui cherchent à les « normaliser » joue un rôle de cause ou de conséquence.
La récusation de la norme par l’exception
Dans ces différentes « disciplines », la mouvance woke opère toujours de la même façon, en rejetant la validité d’une norme sociale, morale ou scientifique par la mise en avant de l’exception à celle-ci, dans le prolongement du relativisme culturel. La mouvance queer est la plus explicite dans cet objectif, la fluidité permettant de récuser toutes les catégories et normes, « oppressives » par nature. C’est d’ailleurs à ce titre que Judith Butler encourage le fait de ne pas définir le postmodernisme, afin de le préserver du piège de la catégorisation.
Ce refus de toute norme est plus évident encore chez les partisans des fat studies, qui réduisent l’injonction à soigner les formes d’obésité dite sévère ou morbide à une pure construction sociale – la preuve d’un nutritionnisme omniprésent – au service des dominants. La médecine étant formelle sur les liens entre le surpoids et les risques pour la santé, celle-ci est dépeinte comme une stratégie pour opprimer des marginalisés.
Le schéma est identique, quel que soit le sujet : commencer par repérer une norme ou un idéal mis en avant – dans le cas des fat studies, celui d’essayer de ne pas être en surpoids –, puis mettre en avant des personnes en surpoids, en insistant sur leur statut de personnes marginalisées. La norme apparaît alors progressivement indéfendable moralement, surtout lorsque l’on impute à ceux qui s’y conforment le statut d’oppresseurs. Le relativisme de ces intellectuels militants leur permet ensuite de balayer tous les contre-arguments moraux ou scientifiques, réduits à des complots à l’encontre de la « communauté marginalisée » – les termes « systémique » ou « structures de pouvoir » ne les obligeant pas nécessairement à identifier nommément des comploteurs. Toutefois, le recours à un argument ad hominem n’est pas à exclure car si quelqu’un s’oppose à ces thèses, c’est qu’il est au mieux naïf (ayant grandi dans cette culture toxique, il n’est pas capable de la percevoir comme telle) ou, au pire, malveillant (car il souhaite sciemment se défendre pour continuer à jouir de sa position de dominant). La possibilité d’un désaccord sincère, étayé et désintéressé est ainsi dès le début désactivée.
Des concepts philosophiques et sociologiques aux méthodes d’action
Voir Eve Kosofsky Sedgwick, Épistémologie du placard [1991], Éditions Amsterdam, 2008.
Cité in Alan Sokal, Pseudosciences et Postmodernisme. Adversaires ou compagnons de route ?, Odile Jacob, 2005, p. 111.
Pierre-André Taguieff, op. cit., p. 41.
Houria Bouteldja, « Élisabeth, va t’faire intégrer », indigenes-republique.fr, 16 septembre 2009.
De son propre aveu, la pensée woke manie des concepts pour les effets qu’ils vont produire plus que pour leur pertinence en soi. En d’autres termes, elle défend rarement des principes mais plutôt des méthodes. Ainsi, la cohérence interne d’une pensée devient secondaire par rapport à l’objectif qui est de promouvoir une cause globale. Il est considéré possible tout à fait légitime de faire exister un concept sous une forme incohérente, contradictoire ou mal définie s’il permet la progression d’une finalité jugée bonne.
La cohérence peut même parfois se muer en inconvénient. Eve Kosofsky Sedgwick, figure importante de la philosophie queer, valorise la contradiction et l’incohérence pour leur faculté à rendre plus difficile la compréhension du mouvement qu’elle défend26. Une éminente théoricienne de la mouvance postcoloniale, Gayatri Chakravorty Spivak, fait quant à elle l’éloge de la notion d’« essentialisme stratégique », c’est-à-dire d’une approche visant à essentialiser tel ou tel groupe marginalisé en fonction de situations jugées politiquement opportunes afin de mieux résister aux « colonisateurs27 », les contradictions internes devenant là aussi une question secondaire. Cet essentialisme stratégique reflète ce que Pierre-André Taguieff appelle la « xénophilie sélective » des militants décoloniaux28.
Sachant qu’il est plus facile de faire adhérer à un principe plutôt qu’à une méthode, les militants, qui ont appris à ne pas surestimer l’importance de la cohérence logique, ont tendance à formuler ces méthodes comme des principes. On pourrait croire, par exemple, que la diversité est défendue en tant que telle, mais il n’y a pas le choix dans ce logiciel pour qu’un penseur ou un militant woke se plaigne un jour, au nom du principe de la diversité, qu’il n’y ait pas assez d’hommes blancs (ou hétérosexuels) dans un pays, un quartier ou une institution. Si la diversité était réellement chérie en soi, ce comportement devrait pourtant s’observer de temps à autre. Son absence révèle en creux l’approche conséquentialiste de ces militants, le discours diversitaire ne s’avérant être qu’un moyen pour la « déblanchisation » de la société. C’est ainsi qu’il faut comprendre les propos d’Houria Bouteldja, la fondatrice du Parti des indigènes de la République : « Notre simple existence, doublée d’un poids démographique relatif (1 pour 6) africanise, arabise, berbérise, créolise, islamise, noirise, la fille aînée de l’église [sic], jadis blanche et immaculée29.» L’affaiblissement (voire la disparition) des personnes considérées « dominantes », c’est-à-dire l’ensemble des Occidentaux blancs, est donc la finalité réelle, et la défense apparente de la diversité en tant que principe n’est qu’une stratégie en vue de cette fin.
La stratégie virale
Voir Breanne Fahs et Michael Karger, « Women’s Studies as Virus: Institutional Feminism, Affect, and the Projection of Danger », Géneros, vol. 5, n° 1, février 2016, p. 929-957.
Jacques Derrida, in Peter Brunette et David Wills, « The Spatial Arts, an interview with Jacques Derrida », in Peter Brunette et David Wills (dir.), Deconstruction and the Visual Arts. Art, Media, Architecture, Cambridge University Press, 1994, p. 12 [traduction de l’auteur].
Avec cette approche stratégique des concepts – un bon concept est un concept qui engendre de « bons » effets –, il n’est pas surprenant de constater que les penseurs woke se théorisent eux-mêmes positivement comme des diffuseurs de virus. Les auteurs d’un article académique de 2016 comparent le féminisme à des maladies comme l’Ebola ou le sida dans le but de répandre leur conception du féminisme comme un virus capable de résister aux défenses immunitaires des organismes et de motiver des étudiants activistes à se métamorphoser en porteurs de ce dernier 30. Cette vision se retrouve déjà dans l’œuvre de Jacques Derrida, qui résumait ses propres travaux comme une « parasitologie, une virologie31 ». Pour qu’un virus infecte son hôte, il lui faut apprendre à l’imiter avant de le subvertir de l’intérieur, une métaphore que l’on retrouvera lorsqu’il s’agira d’étudier la capacité de ces militants à prendre le contrôle de certaines institutions.
Les conditions culturelles et sociales de l’émergence du wokisme
Voir Bradley Campbell et Jason Manning, The Rise of Victimhood Culture. Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars, Palgrave Macmillan, 2018 [les passages de cet ouvrage cités dans cette note sont des traductions proposées par l’auteur].
L’émergence de la pensée woke a requis certaines conditions sociologiques. Ces dernières ont été notamment étudiées par les sociologues Bradley Campbell et Jason Manning, dans un ouvrage paru en 201832. Le terme « woke » y apparaît peu, car ils lui préfèrent celui de « culture de la victimisation », qu’ils jugent plus pertinent pour leur approche.
Contre la culture de l’honneur et contre la culture de la dignité : la promotion d’une culture de la victimisation
Voir Eric Owens, « Police say 28-year-old undergrad threatened herself with rape in Facebook hoax », dailycaller.com, 1er mai 2013.
Voir Bradley Campbell et Jason Manning, op. cit., p. 113.
Ibid., p. 106.
Selon Campbell et Manning, la culture de la victimisation se différencie aussi bien de la culture de l’honneur que de la culture de la dignité. Ces deux dernières dominaient respectivement les sociétés traditionnelles et la modernité. La culture de l’honneur valorise le fait de défendre vigoureusement son honneur, souvent en provoquant en duel son adversaire ; elle répugne à recourir à la loi et à des tierces personnes pour régler ses différends. La culture de la dignité, elle, pousse à ne pas s’offenser pour des vétilles et à régler ses désaccords par le truchement de la justice dans les seuls cas où ils le méritent. À l’opposé, la culture de la victimisation encourage la capacité à se sentir offensé, à régler ses griefs à travers les interventions de tiers. Le statut de victime fait l’objet d’une sacralisation. La prolifération ces dernières années de fausses accusations et de hate crime hoaxes (« fausses accusations d’actes haineux ») sur les campus33 est un fait social que ces auteurs ont interrogé. Il est une illustration de l’émergence de cette nouvelle culture. Or, une fois les mensonges éventés et les manipulations dévoilées, les conséquences sociales pour les semeurs de troubles s’avèrent minimes voire inexistantes34, à condition que leurs « canulars » placent dans la position du bourreau une personne considérée « dominante » et dans la position de la victime une personne considérée « dominée ». Ainsi, à titre d’exemple, après avoir admis en 2011 avoir fabriqué de toutes pièces son témoignage narrant une violence policière raciste commise à son égard, Jonathan Perkins, étudiant en droit de l’université de Virginie, a justifié sa calomnie par la volonté d’« attirer l’attention sur le sujet des bavures policières ». Dans le droit fil de la pensée woke, la valeur de la finalité – ici la justice sociale – suffit à justifier le recours à ce type de moyen. On notera que les policiers injustement accusés ne sont pas admis dans la catégorie des victimes.
La conclusion tirée par Manning et Campbell de ces événements est la suivante : « Si le statut de victime ne conférait aucun avantage, pourquoi tout cela se produirait-il ? Pourquoi quelqu’un prétendrait-il faussement être une victime s’il n’y avait aucun avantage à le faire ? Le fait qu’ils le fassent démontre que le statut de victime est en réalité une ressource sociale, une forme de statut35. »
Promouvoir l’intervention de tierces personnes pour la gestion des griefs
Cité in Bradley Campbell et Jason Manning, op. cit., p. 3.
Voir Adam Nicholas Phillips, « #BlackLivesMatter: why we need to stop replying all lives matter », sojo.net, 4 décembre 2014.
Voir Robert Shimshock, « UNC claims Christmas vacations, golf outings are microaggressions », ampusreform.org, 24 juin 2016.
Bradley Campbell et Jason Manning, op. cit., p. 41.
Cité in Eleanor Busby, « Exeter University law students suspended over “racist” WhatsApp messages », independent.co.uk, 20 mars 2018 [traduction de l’auteur].
Cité in Jamie Hawkins, « Rally to take place at Exeter University today after racism scandal », devonlive.com, 22 mars 2018 [traduction de l’auteur].
Cité in Eleanor Busby, art. cit.
Cité in « Ibram X. Kendi says we are either being racist or antiracist, there is no middle ground », cbc. ca, 15 février 2019 [traduction de l’auteur].
Bradley Campbell et Jason Manning, op. cit., p. 86.
Ibid.
Voir Jon Marcus, « The Reason Behind Colleges’ Ballooning Bureaucracies », theatlantic.com, 6 octobre 2016, ainsi que Greg Lukianoff, Unlearning Liberty. Campus Censorship and the End of American Debate, Encounter Books, 2014.
Voir Wendy McElroy, « Administrative Bloat on Campus: Academia Shrinks, Students Suffer », jamesgmartin.center, 6 juin 2017, ainsi que Andrea Vacchiano, « Colleges Pay Diversity Officers More Than Professors, Staff », dailysignal.com, 14 juillet 2017.
L’approche conséquentialiste du wokisme fait qu’une manière de comprendre certains comportements d’étudiants sur les campus consiste à se demander ce qu’ils cherchent à accomplir. Quel est le but des fausses accusations, des discours sur les safe spaces (« espaces protégés ») et des microagressions ? Outre l’effet de générer de nouvelles victimes à partir de la définition de nouvelles oppressions, les attitudes de certains étudiants ont souvent comme conséquence d’obliger des tierces personnes à intervenir. La définition d’une « microagression » est donnée par Derald Wing Sue, qui a grandement contribué à faire connaître cette expression. Il s’agit d’« indignités verbales, comportementales et environnementales quotidiennes, brèves et banales, intentionnelles ou non, qui transmettent à la personne ou au groupe cible des invectives hostiles, désobligeantes ou négatives liées à la race, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à la religion36 ». Notons déjà que, contrairement à une agression, une microagression ne requiert aucune intention malfaisante. Cela permet de classifier potentiellement un nombre infini de comportements et de propos dans cette catégorie. Dire, par exemple, « all lives matter37 » ou complimenter une femme pour ses chaussures38 ont déjà été inscrits dans cette catégorie.
Les étudiants woke profitent du flou qui entoure la notion de microagression ainsi que les raisons pour lesquelles sa connotation serait jugée violente et dangereuse pour légitimer des interventions extérieures. Comme le rapportent Campbell et Manning : « Lorsque des personnes publient des comptes rendus de microagressions sur des sites Web ou qu’elles les signalent à des administrateurs de campus, elles exposent publiquement leurs griefs à des personnes qui, autrement, n’en auraient peut-être pas eu connaissance. Ce faisant, elles recrutent d’autres personnes pour se joindre au conflit. Et elles le font parfois dans le but déclaré d’obliger d’autres personnes à agir39. »
Si un tort subi par une victime est perçu comme étant particulièrement fort (décrit par un terme qui contient le mot « agression », par exemple), la probabilité d’une intervention extérieure augmente. Même effet si le préjudice se répète sur une classe de personnes, telle qu’une minorité. Et si l’agression présumée est réputée émaner d’une logique « systémique », c’est-à-dire procéder de l’ensemble du système, alors l’intervention d’une tierce personne sera jugée obligatoire.
C’est ainsi qu’à l’université d’Exeter, en 2018, lorsqu’une discussion WhatsApp privée entre une poignée d’étudiants en droit contenant des blagues et des propos racistes a été révélée, certains y ont vu la preuve irréfutable que l’université tout entière souffrait de racisme40. L’étudiant qui a dénoncé ses camarades sur Twitter et aux autorités universitaires déclarait : « L’université d’Exeter a un sérieux problème de racisme qu’elle doit régler de toute urgence et en établissant un précédent41. »
Conformément à la culture de la victimisation, une intervention est ici explicitement souhaitée, et la fermeté de celle-ci se légitime par l’omniprésence apparente du tort. Deux jours plus tard, le groupe « Exeter Unmasked » organisait d’ailleurs une manifestation qui appelait aux témoignages de ceux qui auraient pu observer des propos ou actes racistes sur le campus, et les organisateurs affirmaient vouloir « mettre en évidence les problèmes systémiques plus larges qui ont provoqué ces commentaires », ainsi que leur volonté de « décoloniser » l’université42.
À la suite de cet incident, la réaction de l’université ne s’est pas fait attendre : la Bracton Law Society, dont faisaient partie les étudiants, a été dissoute, cinq élèves ont été exclus de l’université et la police s’en est même mêlée. Une fois ces mesures prises, l’étudiant qui avait déclenché l’affaire s’est réjoui publiquement du résultat. De plus, la bureaucratie universitaire d’Exeter a pu simultanément légitimer son utilité et étendre son influence, puisqu’une nouvelle Provost Commission a vu le jour depuis cet incident, avec pour ambition d’œuvrer pour « une communauté universitaire ouverte, diverse et sûre43 ».
Outre la tendance à élargir l’étendue d’un tort ou d’en aggraver la portée, ceux qui baignent dans la culture de la victimisation cherchent généralement à imposer un cadre binaire auquel il est impossible d’échapper, ce qui a pour effet d’interdire aux simples passants une position de neutralité ou d’indifférence. Ici, un lien peut être tracé avec la pensée d’Ibrahim X. Kendi qui déclarait, en 2019, qu’« il n’y a pas de politique “non raciste” ou “neutre” », car, pour ce penseur woke, il n’y aurait que « raciste » face à « antiraciste44 ». Ne souhaitant pas être jugé en position raciste, le spectateur non partisan se voit bien souvent contraint de prendre position et donc d’intervenir en faveur de la personne rangée dans la catégorie des « dominés ».
La stratégie pour encourager l’intervention de tierces personnes varie car les sources de légitimité de l’intervention elle-même peuvent varier. La foule tire la légitimité de son nombre, et il s’agira dans ce cas de pousser essentiellement les réseaux sociaux à se mobiliser, souvent à l’aide d’un hashtag producteur de viralité, pour mettre en évidence une injustice supposée et faire pression sur le bourreau présumé ou sur son employeur pour mettre fin à un contrat en cours. C’est en ce sens qu’il peut se révéler utile d’interpréter la cancel culture (« culture de l’annulation » ou « culture du bannissement ») comme une variante de plus de l’intervention d’une tierce partie, soit, ici, l’intervention de l’employeur sommé de rompre tous les liens contractuels, voire amicaux, avec son employé devenu « problématique ». Notons que les réseaux sociaux permettent de démultiplier le nombre de tierces personnes virtuelles qui peuvent potentiellement venir au secours d’hypothétiques victimes lors d’une dispute. De ce point de vue, on peut se demander si ce mouvement aurait pu éclore sans la présence des réseaux numériques.
Sur les campus, si l’attention des réseaux sociaux est presque toujours recherchée, l’objectif primordial reste l’intervention de l’administration – les deux sont d’ailleurs complémentaires, la pression d’un hashtag hâtant l’intrusion bureaucratique dans une altercation. Appâter une administration universitaire nécessite cependant une approche assez spécifique. Le fait de masquer des revendications en utilisant une justification perçue comme objective, souvent issue du domaine de la psychologie, semble être une approche particulièrement performante. Comme le soulignent Campbell et Manning, « lorsqu’un groupe d’étudiants de Yale a exigé que les poètes blancs soient retirés du programme, ils n’ont pas formulé leur demande sous la forme d’une préférence (“Nous préférons lire des poètes non blancs”) ni même sous la forme d’une question de vertu (“La diversité ethnique est une bonne chose”), mais plutôt en insistant sur le fait que les étudiants allaient en souffrir45 ». De plus, lorsque l’on souhaite faire annuler la venue d’un conférencier, la méthode la plus efficace consiste à soutenir que son discours est une « mise en danger » des étudiants46. C’est ici que l’intervention d’instances administratives vient tout naturellement se justifier par la volonté simple de protéger des élèves.
Le cas de l’université d’Exeter a révélé comment une intervention administrative a pu légitimer non seulement l’utilité de la bureaucratie existante mais également la création de nouvelles structures. Au vu de la multiplication impressionnante de comités, de commissions et autres instances bureaucratiques depuis quelques années dans les universités américaines47, avec des postes souvent mieux rémunérés que ceux des professeurs48,ces structures apparaissent efficaces pour justifier leur propre existence et favoriser l’élargissement constant de leur domaine de compétence. Le wokisme est, à ce titre, une occasion propice pour ce faire.
Atomisation sociale et bureaucratisation des rapports sociaux
Bradley Campbell et Jason Manning, op. cit., p. 53.
Ibid.
Ibid.
Richard Reeves et Dimitrios Halikias, « Illiberal Arts Colleges: Pay More, Get Less (Free Speech) », realclearmarkets.com, 14 mars 2017 [traduction de l’auteur].
Une difficulté dans l’établissement rigoureux de ce critère est que les militants woke, comme en témoignent la popularité des disability ou fat studies, sont particulièrement compétents pour « créer » de la « diversité ». Ainsi, des personnes qui se diagnostiquent elles-mêmes comme étant autistes peuvent se déclarer en dehors de la norme et réclamer une discrimination positive à leur égard. Les axes d’oppression au sein du schéma intersectionnel s’avérant jusqu’ici illimités, la « diversité » se révèle elle aussi potentiellement sans fin. Cependant, le sujet de l’oppression raciale étant un des plus chronophages pour les militants, et la diversité ethnique étant l’une des plus faciles à mesurer avec certitude, ce critère de diversité se révèle particulièrement puissant.
Bradley Campbell et Jason Manning, op. cit., p. 62.
En toute logique, Campbell et Manning voient dans la présence d’une bureaucratie forte et étendue l’une des conditions de l’émergence de la culture de la victimisation. Cette bureaucratie sert d’autorité supérieure apparemment neutre pour régler les nombreux griefs générés par cette culture morale. Ces structures sont aussi le fruit d’une atomisation sociale : on recourt à ces nouvelles normes juridiques pour compenser l’affaiblissement des liens familiaux, communautaires ou religieux.
Cet affaiblissement des liens sociaux est la deuxième condition identifiée par Campbell et Manning. En effet, les interventions bureaucratiques et les foules, digitales ou réelles, deviennent nécessaires lorsque l’on n’est plus assuré d’avoir assez de partisans déjà acquis à sa cause. Les campagnes de communication victimaires n’ont aucun sens dans une société où les communautés sont fortes, car le soutien de son groupe d’appartenance y est garanti d’avance. Ces auteurs le résument ainsi : « Les campagnes de soutien n’apparaissent pas là où la structure de la partisannerie favorise des alliés forts ou des ennemis forts, mais quelque part entre les deux, là où les tiers partis ne peuvent offrir qu’un soutien faible ou potentiel49. » L’université contemporaine, où le corps étudiant change chaque année et vit souvent loin de sa famille, remplit parfaitement ce critère d’atomisation sociale50.
Les étudiants qui prêchent cette culture de la victimisation sont presque toujours issus des classes sociales les plus aisées, et c’est un critère supplémentaire à prendre en compte. La corrélation entre revenus élevés des parents et comportements woke est indéniable51. Par exemple, une analyse de quatre-vingt-dix cas d’intervenants « désinvités » révèle que « l’étudiant moyen inscrit dans une université où les étudiants ont tenté de restreindre la liberté d’expression est issu d’une famille dont le revenu annuel est supérieur de 32.000 dollars à celui de l’étudiant moyen en Amérique52 ». Et comme la culture des « élites » a tendance à être imitée par ceux qui souhaiteraient en faire partie, celle-ci peut s’étendre progressivement à l’ensemble des classes sociales.
Une autre condition identifiée est la présence d’une diversité visible, quelle qu’elle soit. En effet, pour qu’il y ait une discrimination réelle ou apparente, il faut une base sur laquelle discriminer des oppresseurs et des opprimés bien définis et facilement identifiables53. Là encore, les universités (américaines) remplissent ce critère. Campbell et Manning rappellent qu’« entre 1976 et 2008, le pourcentage d’élèves blancs est passé de 82% à 63%, tandis que les pourcentages d’élèves asiatiques, noirs et hispaniques ont augmenté54 ». L’augmentation de la diversité sur les campus, loin d’être reconnue comme un progrès de la justice et de l’égalité, est l’une des conditions paradoxales de l’émergence de la revendication identitaire du wokisme. Selon ces auteurs, le dernier critère sociologique nécessaire pour l’émergence de la culture de la victimisation est un haut niveau d’égalité, illustrant à nouveau ce paradoxe tocquevillien : moins il y a de discriminations réelles, plus les protestations contre les discriminations résiduelles ou illusoires se multiplient.
La psychologie woke
Greg Lukianoff et Jonathan Haidt, The Coddling of the American Mind. How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure, Penguin Press, 2018 [les passages de cet ouvrage cités dans cette note sont des traductions proposées par l’auteur].
L’ouvrage qui traite de l’aspect psychologique de ces étudiants militants de la façon la plus détaillée à ce jour est celui des psychologues Greg Lukianoff et Jonathan Haidt, The Coddling of the American Mind, publié en 201855.
Une dérive éducative : surprotection et safetyism
Voir à ce sujet la démonstration de Nadia Daam, « Comment nous sommes devenus les Big Brother de nos enfants », slate.fr, 3 octobre 2014. Cette question était déjà un sujet d’inquiétude soulevé par Christopher Lasch dans son livre La Culture du Narcissisme [1979], Flammarion, coll. « Champs essais », 2008, qui déplorait le « déclin de l’esprit de jeu ».
Voir, notamment, Jean Piaget, La Formation du symbole chez l’enfant. Imitation, jeu et rêve, image et représentation, Delachaux & Niestlé, 8e éd., 1978.
Steven Horwitz, « Cooperation over Coercion: The Importance of Unsupervised Childhood Play for Democracy and Liberalism », Cosmos + Taxis, vol. 3, n° 1, 2015, p. 10.
Greg Lukianoff et Jonathan Haidt, op. cit., p. 48.
Ibid., p. 94-95.
Comme montré précédemment, l’immense majorité des étudiants engagés dans le wokisme ont des parents nettement plus aisés que la moyenne américaine. Lukianoff et Haidt se sont penchés sur l’éducation qu’ont reçue ces jeunes. Les parents des classes aisées ont tendance à surveiller leurs enfants bien plus que les parents des classes populaires. Dans les classes populaires, les parents laissent leurs enfants passer plus de temps avec leurs camarades, sans adultes. Ces enfants s’habituent donc à régler leurs différends tout seuls. Chez les enfants des classes aisées, l’érosion progressive du temps moyen de leurs instants de jeu libre56 empêcherait le bon développement de l’enfant, un fait montré notamment dans les travaux du psychologue Jean Piaget57. Adolescent puis jeune adulte, l’individu garderait le besoin de régler ses griefs avec ses semblables en recourant à une intervention extérieure, souvent issue d’une autorité formelle.
L’économiste Steven Horwitz en tire les conclusions suivantes : « Les approches parentales et les lois qui font qu’il est plus difficile pour les enfants de jouer seuls constituent une menace sérieuse pour les sociétés libérales, car elles modifient notre disposition normale à “trouver une solution à un conflit par soi-même” en une disposition à “faire appel à la force et/ou à des tiers dès qu’un conflit survient”58. » Sous cet angle, la bureaucratie universitaire omniprésente vient remplacer l’attention excessive des parents des enfants issus des classes aisées.
En d’autres termes, les helicopter parents, ces parents qui surveillent en permanence leurs enfants, génèrent des helicopter bureaucracies, et la surprotection de l’enfant devient la surprotection de l’étudiant dans le monde universitaire. Cette surprotection a ainsi généré une fragilité, et cette fragilité entraîne une demande de surprotection. La surprotection est donc un processus qui s’autoalimente. Sans surprise, la culture forgée par ces jeunes sacralise la protection, et se voit qualifiée par ces deux psychologues de safetyism, terme que l’on pourrait traduire par « protectionnite ». Lukianoff et Haidt rapportent qu’en 2017 « 58% des étudiants universitaires ont déclaré qu’il était “important de faire partie d’une communauté universitaire où [ils ne sont pas exposés] à des idées contrariantes et offensantes”59 ». Cette culture de la protection pousse paradoxalement à accepter l’usage de la violence contre ceux qui ne la respectent pas. Ainsi, dans une enquête d’opinion réalisée la même année, on apprend que si seulement 1% des étudiants se disent prêts à recourir à la violence pour empêcher quelqu’un de s’exprimer sur le campus, 20 à 30% d’entre eux toléreraient que quelqu’un d’autre le fasse à leur place. Ces dernières années, les nombreux cas où des conférenciers américains non woke ont été violemment chahutés ou attaqués par des étudiants ont souvent été présentés comme des actes relevant de la légitime défense 60.
La psychologisation des griefs
Bradley Campbell et Jason Manning, op. cit., p. 75.
Voir Rosy Cordero, « Mad Men finds new streaming home, and it’ll debut with a blackface warning », ew.com, 1er juillet 2020.
Voir Bradley Campbell et Jason Manning, op. cit., p. 76.
Voir Nick Haslam, « Concept Creep: Psychology’s Expanding Concepts of Harm and Pathology », Psychological Inquiry, vol. 27, n° 1, février 2016, p. 1-17. Cité in The Coddling of the American mind, op. cit.
Jonathan Haidt et Greg Lukianoff, op. cit., p. 24.
Ibid., p. 25.
En reformulant leurs griefs en termes psychologiques, les étudiants aident les bureaucraties universitaires à légitimer plus aisément leurs interventions. Le concept de trigger warning, par exemple, relève du domaine psychologique. Ce terme fait référence aux « effets du syndrome de stress post-traumatique (SSPT), un état mental dans lequel les personnes ayant vécu des situations extrêmes peuvent ressentir ultérieurement des symptômes tels que des crises de panique et des flash-back dans lesquels elles revivent des aspects de l’événement traumatique. Un élément déclencheur [trigger] devient n’importe quelle expérience qui produit ces symptômes61 ». Un ancien soldat traumatisé, par exemple, peut ainsi subir une crise de SSPT après avoir regardé un film de guerre. Anticiper qu’une scène de film, qu’un passage de livre ou qu’un mot qui apparaît est susceptible d’être triggering (« déclencheur ») permet temporairement d’éviter une crise, mais il arrive que des trigger warnings se voient eux-mêmes qualifiés de trigger warnings de par leur faculté à générer du stress chez certains sujets.
Parfaitement compréhensible lorsqu’il s’applique à des soldats traumatisés, ce concept a subi, comme nombre d’autres, un élargissement de son champ d’application qui le rend difficilement définissable. Ainsi, Prime Video utilise un trigger warning pour informer ses auditeurs qu’un épisode de Mad Men comporte un blackface62.De la même manière, Les Métamorphoses d’Ovide ou encore Gatsby le Magnifique se voient attribuer des trigger warnings63. Cette évolution est qualifiée par Nick Haslam de concept creep64, expression que l’on pourrait traduire par « glissement conceptuel ». À titre d’exemple, sur les campus le terme « sécurité » en est venu à inclure ces dernières années la notion de « sécurité émotionnelle65 » et un étudiant qui ne se verrait pas désigné par les bons pronoms (il, elle, le, la, « iel » pour les « non binaires »…) pendant un cours peut désormais se dire « en danger66 ». Le concept de « traumatisme » est un autre exemple : initialement très strict, réduit, et rigoureux avant les années 1980, son sens a progressivement glissé pour recouvrir des notions subjectives. Pour Haslam, les concepts peuvent glisser à la fois verticalement, pour se mettre à englober des situations moins sévères, et horizontalement, pour inclure des phénomènes reliés mais distincts. Cependant, il ne faut pas oublier qu’ils gardent encore une partie de leur légitimité initiale ainsi que leur apparence d’objectivité, qui est cruciale, devenant de fait des armes lexicales redoutables.
Exposition aux écrans, troubles psychologiques et wokisme
Ibid., p. 150.
Ce serait cependant faire fausse route que de réduire l’utilisation de concepts psychologiques à une simple stratégie qui chercherait à favoriser l’intervention de la bureaucratie universitaire. Tout porte à croire en effet que les liens entre troubles psychologiques et wokisme sont nombreux. Lukianoff et Haidt notent que le début de la banalisation des comportements woke sur les campus, en 2013, coïncide avec l’année où la « iGen » (1995+) arrive dans les universités. Cette génération se définit par le fait d’être la première à grandir dans le monde des réseaux sociaux et des écrans omniprésents. Ce bouleversement a eu un impact négatif disproportionné sur les jeunes filles, qui tombent beaucoup plus facilement en dépression depuis l’arrivée des réseaux sociaux (en 2018, une femme sur sept sur les campus américains pensait souffrir d’un désordre psychologique). De plus, « par rapport au début des années 2000, près de deux fois plus d’adolescentes mettent fin à leurs jours67 ». Le graphique ci-dessous montre qu’être Américain blanc, progressiste (liberal), jeune et de sexe féminin sont autant de critères qui peuvent potentiellement amener à souffrir d’un trouble psychologique.

Source :
Source : Pew American Trends Panel, vague 65 (19-24 mars 2020).
Si tous les liberals (synonyme de « de gauche » ou « progressiste » pour les Américains) ne sont certainement pas woke – distinction qui sera creusée dans le second volume de notre note –, le fait que le sondage n’offre que ces trois options a certainement dû pousser la quasi-totalité des woke à se classer eux-mêmes parmi les liberals. On les imagine en effet difficilement se traiter de moderate ou de conservative.
Jonathan Haidt et Greg Lukianoff, op. cit., p. 277.
Cette phrase vise bien évidemment à renverser la célèbre phrase de Nietzsche, « Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort » (Le Crépuscule des idoles, trad. Henri Albert, partie « Maximes et flèches », §8, in Œuvres, t. II, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1993, p. 950), afin de parodier leur désir de surprotection.
Helen Pluckrose et James Lindsay, op. cit., p 132.
On pourrait être tenté d’expliquer l’écart entre les « progressistes68 » et les « conservateurs » par l’hypothèse qu’une éducation de gauche porte davantage à admettre ses soucis psychologiques et à chercher à les traiter plutôt que de les garder pour soi, mais la terrible statistique concernant les suicides parmi les jeunes filles n’est pas cohérente avec ce type d’explication. De plus, cette hypothèse n’expliquerait pas non plus le clivage de genre très marqué au sein des jeunes générations.
Les personnes déprimées et les militants woke partagent également des façons de raisonner. Les dix-sept « distorsions cognitives » (ou « biais cognitifs ») énumérées par Lukianoff et Haidt, que l’on retrouve régulièrement chez les sujets qui souffrent de dépression, sont parfois ouvertement encouragées par les concepts et militants woke. La tendance à généraliser, à « percevoir un pattern global négatif à partir d’un seul incident69 », se retrouve dans leur volonté de partir d’événements particuliers – comme un groupe WhatsApp raciste – pour en déduire hâtivement une réalité générale néfaste. Le désir de penser en termes binaires en fait également partie, ainsi que la volonté de « filtrer négativement » (negative filtering), c’est-à-dire se concentrer presque exclusivement sur les réalités négatives sans remarquer celles qui sont positives. Si certaines de ces descriptions peuvent se rapporter à des militants de tous bords, le militant woke remplit trop bien les critères pour que la corrélation n’interpelle pas.
Est-ce la pensée woke qui favorise ce genre de troubles, ou bien ces troubles poussent-ils à « penser woke » ? Comme le font remarquer Manning et Campbell, il est indéniable que les campagnes très visibles et bruyantes – dans la logique consistant à empêcher l’« invisibilisation » des minorités par le système du pouvoir en place – autour des microagressions sur les campus poussent les étudiants à pratiquer nombre de ces distorsions cognitives. Pour Lindsay et Pluckrose, les « trois grandes contrevérités » de la pensée woke telles qu’énumérées par Lukianoff et Haidt – « Tout ce qui ne te fait pas mourir te rend plus faible70 », « Fais toujours confiance à tes sentiments », « La vie est un combat entre des gentils et des méchants » – risquent de favoriser une mentalité négative, paranoïaque et autodestructrice71.
Les conséquences individuelles du wokisme
En se penchant sur les conséquences que peut avoir l’idéologie woke sur ceux qui y adhèrent, on se rend compte rapidement que ces derniers sont exposés au risque de se radicaliser et de s’enfermer progressivement dans leurs certitudes.
Accentuation des troubles psychologiques
Helen Pluckrose et James Lindsay, op. cit., p. 171.
Greg Lukianoff et Jonathan Haidt, « The Coddling of the American Mind », theatlantic.com, septembre 2015.
Bradley Campbell et Jason Manning, op. cit., p. 9.
Greg Lukianoff et Jonathan Haidt, The Coddling of the American Mind. How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure, Penguin Press, 2018 [les passages de cet ouvrage cités dans cette note sont des traductions proposées par l’auteur], p. 29.
Benjamin W. Bellet, Payton J. Jones, Richard J. McNally, « Trigger warning: Empirical evidence ahead », Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, vol. 61, décembre 2018, p. 134 [traductions de l’auteur].
Les disability studies, qui considèrent les troubles mentaux comme une identité minoritaire qu’il faudrait célébrer, peuvent recommander à leurs adeptes de ne pas se soigner. Comme le notent Pluckrose et Lindsay, « la tentation peut être grande de devenir plus handicapé plutôt que moins handicapé et de se concentrer de manière excessive sur son handicap. Cela est particulièrement troublant si les personnes peuvent s’auto-identifier comme handicapées sans diagnostic professionnel ni soins médicaux72 ».
Ainsi, en cohérence avec le relativisme scientifique qui réduit l’avis des scientifiques à des constructions sociales en faveur des puissants, ces personnes s’encouragent mutuellement à se diagnostiquer elles-mêmes. En écrivant « autodiag » dans la barre de recherche Twitter, les nombreux comptes qui affichent ce terme dans leur titre ou leur description en France indiquent que ce phénomène est déjà très répendu et qu’il touche vraisemblablement une nouvelle fois principalement des jeunes femmes, un exemple supplémentaire de l’engagement plus élevé des jeunes femmes dans le wokisme.
En 2015, les psychologues Greg Lukianoff et Jonathan Haidt soulignaient le fait que la généralisation du thème des micro-agressions encourage les distorsions cognitives qui sont des causes de dépressions et d’anxiété73. Ceux qui pratiquent les thérapies comportementales et cognitives (cognitive behavioural therapy ou CBT) cherchent à soigner leurs patients en leur apprenant à identifier ces distorsions et à les corriger, soit l’exact inverse de ce que fait le wokisme. Campbell et Manning font remarquer que « le fait d’amplifier les petites offenses, d’examiner les conceptions et les représentations afin d’identifier des pensées dont même les oppresseurs ne sont pas conscients, et d’étiqueter ces derniers comme des agresseurs fait partie intégrante du programme de micro-agressions, lequel peut nuire à la santémentale74 ».
Le processus est le même pour les trigger warnings. Pour Lukianoff et Haidt, « éviter les déclencheurs [trigger] est un symptôme du SSPT [syndrome de stress post-traumatique] et non un traitement75 ». Une étude publiée en 2018 indique que les trigger warnings pourraient être contre-productifs dans certains cas et qu’ils « peuvent, par inadvertance, saper certains aspects de la résilience émotionnelle » et « augmenter l’anxiété vis-à-vis de textes perçus comme dangereux76 ».
Que ce soit pour la banalisation des micro-agressions ou pour celle des trigger warnings, ces processus (au même titre que la surprotection qui génère plus de fragilité et donc intensifie le besoin de protection) ont donc tendance à s’autoalimenter. De ce point de vue, il paraît psychologiquement difficile pour un jeune qui adhère au wokisme d’en sortir.
Un complotisme favorisant l’intolérance aux désaccords
Lydia X. Z. Brown, cité in Helen Pluckrose et James Lindsay, op. cit., p. 169.
Pierre-André Taguieff, L’Imposture décoloniale. Science imaginaire et pseudo-antiracisme, Éditions de
l’Observatoire, 2020, p. 272.
Helen Pluckrose et James Lindsay, op. cit., p. 46.
Mathieu Bock-Côté, « Marcel Gauchet : retour sur un “procès en sorcellerie” », Le Figaro, 12 août 2014.
Cette réalité est accentuée par l’aspect complotiste du wokisme. Dans l’esprit de certains penseurs des disability studies, c’est « le système » qui fait que l’on perçoit les troubles psychologiques comme étant « anormaux » et qui véhicule des idées néfastes. Une activiste affirme ainsi : « Je ne crois pas qu’il faille donner le pouvoir au complexe médico-industriel et à son monopole de définir et de déterminer qui est considéré comme autiste et qui ne l’est pas77. » Cette logique « systémique » s’avère omniprésente dans le logiciel woke. Pierre-André Taguieff, par exemple, souligne la déresponsabilisation que permet cette manière de penser car l’individu est poussé à externaliser ses échecs afin de les mettre sur le dos « du système » : « La responsabilité individuelle est évacuée : c’est “le système” qui dirige tout, les pensées, les sentiments et les actions des individus, simples marionnettes78. » Pour Pluckrose et Lindsay, le wokisme serait plus précisément « une théorie du complot sans conspirateurs particuliers », en raison de cette perception d’une société régie par des relations de pouvoir qui se perpétuent par des discours présents à tous les niveaux79. Comme dans tout complotisme, la possibilité d’un désaccord étayé et bienveillant est d’avance rejetée. Le « dominant » qui n’est pas d’accord est ignorant et naïf, car il a grandi et vécu dans des sociétés occidentales jugées racistes et sexistes, et tel le poisson qui ne perçoit pas l’eau dans laquelle il baigne, il serait incapable de percevoir le mal dont il est issu et qu’il propage malgré lui. Dans les cas plus sévères, ses paroles seront perçues et réduites à des stratégies pour conserver son monopole dans les sphères du pouvoir. C’est en ce sens qu’il faut interpréter la « psychiatrisation » ou la « pathologisation » du désaccord décrite par l’essayiste Mathieu Bock-Côté80 que l’on peut observer avec la prolifération des attaques verbales suffixées en « phobe ».
Face à une théorie woke, un membre des « dominés » qui affiche son désaccord sera quant à lui accusé de souffrir d’une forme de syndrome de Stockholm ou alors d’avoir intériorisé les dogmes du système en place au point de ne plus pouvoir s’en défaire. Ainsi, une femme qui sera en désaccord avec une théorie woke souffrira probablement d’internalised misogyny, tout comme un noir non woke aura intégré le racisme de la classe dominante. Ici, l’argument valide et le ad hominem se confondent et, partout où il se tournera, le woke ne verra que des confirmations de ses théories.
Théories infalsifiables, biais de confirmation et raisonnements circulaires
Robin DiAngelo, citée in Helen Pluckrose et James Lindsay, op. cit., p. 205.
Citée in Mathieu Bock-Côté, La Révolution racialiste, Presses de la Cité, 2021, p. 128.
Helen Pluckrose et James Lindsay, op. cit., p. 205.
Débat « How to be an Antiracist », Aspen Ideas Festival, 26 juin 2019.
Voir Heather Bruce, Robin DiAngelo, Gyda Swaney (Salish) et Amie Thurber, Between Principles and Practice: Tensions in Anti-Racist Education, Race and Pedagogy National Conference, University of Puget Sound, septembre 2014.
Là encore, comme dans toute théorie aux raisonnements complotistes, le wokisme s’avère souvent infalsifiable. Par exemple, lorsqu’un blanc se voit accusé de « fragilité blanche » – concept promu par Robin DiAngelo – et réagit en conséquence avec « une manifestation extérieure d’émotions telles que la colère, la peur et la culpabilité, et des comportements tels que le fait d’argumenter, de rester silencieux, et le fait de quitter la situation stressante », c’est qu’il en souffre bel et bien81. Qu’il parle ou se taise, il est donc impossible pour un blanc d’échapper à l’accusation.
De manière similaire, la militante racialiste Ally Henny proposait sur Facebook un test de dépistage pour que chacun puisse sonder sa propre « fragilité blanche » à travers seize questions, parmi lesquelles : « Est-ce que j’attends des excuses lorsque je trouve que j’ai été accusée injustement de racisme ? », ou encore : « Ai-je besoin de prouver que je ne suis pas raciste ? ». Selon elle, « si vous avez répondu oui à n’importe laquelle des questions précédentes, vous présentez des traces de fragilité blanche82 ».
Comme le font remarquer Pluckrose et Lindsay, « tout sentiment négatif à l’égard d’un profilage racial et le fait d’être tenu pour responsable d’une société raciste est considéré comme un signe de “fragilité” et comme une preuve de complicité – voire de collusion – avec le racisme83 ». En d’autres termes, le fait de réagir négativement à une catégorisation insultante serait en soi une preuve que la catégorisation visait juste.
Une fois de plus, cette théorie du racisme ne nécessite pas de racistes particuliers. Ainsi, l’individu sincère qui se poserait la question « Suis-je raciste ? » ne peut pas se contenter de ne pas avoir commis d’actes racistes pour répondre par la négative ; il se pourrait qu’il ait malgré lui contribué à alimenter un système qui l’est, et être ainsi complice – voire coupable – de racisme. Lors d’une conférence, en 2019, il a ainsi été demandé à Ibrahim X. Kendi, penseur particulièrement réputé chez les woke, de définir le racisme : « Je définirais le racisme, a-t-il répondu, comme un ensemble de politiques racistes qui conduisent à l’inégalité raciale et qui sont fondées sur des idées racistes84. » Cette définition, qu’il n’hésite pas à répéter une seconde fois à l’identique, est parfaitement circulaire.
Une des prémisses indiscutables chez les penseurs de la Critical Race Theory que défend Kendi est que, quelle que soit la situation donnée, du racisme a bien eu lieu. En 2015, plusieurs chercheuses woke (parmi lesquelles Robin DiAngelo) affirmaient ainsi : « La question n’est pas “Est-ce que du racisme a eu lieu ?”, mais bien “Comment le racisme s’est-il manifesté dans cette situation ?”85 » Une fois cette prémisse établie – et, au fur et à mesure que celle-ci apparaîtra comme une évidence, elle ne sera logiquement même plus mentionnée –, il s’agira donc de déterminer comment le racisme a eu lieu dans une situation donnée. S’est-il manifesté par un mot, un regard, un ton, un objet ? Dans ce domaine, activistes, journalistes et chercheurs – leur survie académique, médiatique et financière en dépend – redoublent de créativité. Cela permet, par exemple, au journaliste britannique Andrew Doyle, qui a créé le personnage satirique Titania McGrath sur Twitter, de s’amuser à compiler toutes les différentes choses qui ont déjà été cataloguées comme étant « racistes » (ou comme fruits d’un système raciste). Parmi la liste de cent quarante-quatre choses, on y retrouve : le poisson, le changement climatique ou encore les céréales86. Une fois les résultats « découverts », la conclusion rejoindra et renforcera la prémisse dans un espace argumentatif parfaitement clos : du racisme a bien eu lieu. L’individu qui adhère à ces théories a donc, une fois de plus, peu de chances de pouvoir s’en extirper.





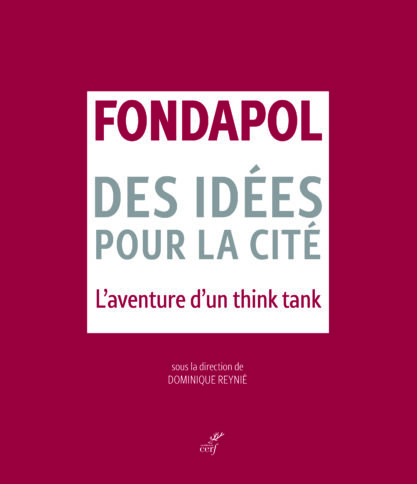



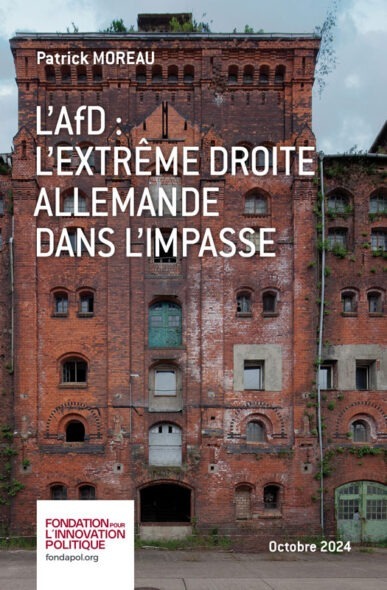



Quand cessera cette science intellectualiste qui catégorise, oppose, crache ? Qui sont ces pseudo-savants qui jugent ces personnes -- sans aucune vergogne, sûrs de leur bon savoir--, et cependant dignes d'être écoutées, comme tout un chacun, et qui les catégorisent à pensée binaire, à la limite de la névrose, mais que font-ils eux-mêmes ? Qui sera assez fort pour unifier, aimer, comprendre, ne pas juger, apporter une parole de paix ? Soyons tous les bâtisseurs d'un monde meilleur ! Il est temps !
Une belle analyse, qui permettra à certains (les neutres, car pour les autres c'est déjà trop tard) de comprendre ce qu'ils aurait du comprendre seuls. Pour ma part, cela a précisé quelques aspects mais ce qui est surtout intéressant, c'est la synthèse qui me permettra de mieux argumenter lors d'une future discussion. Merci et bonne continuation.